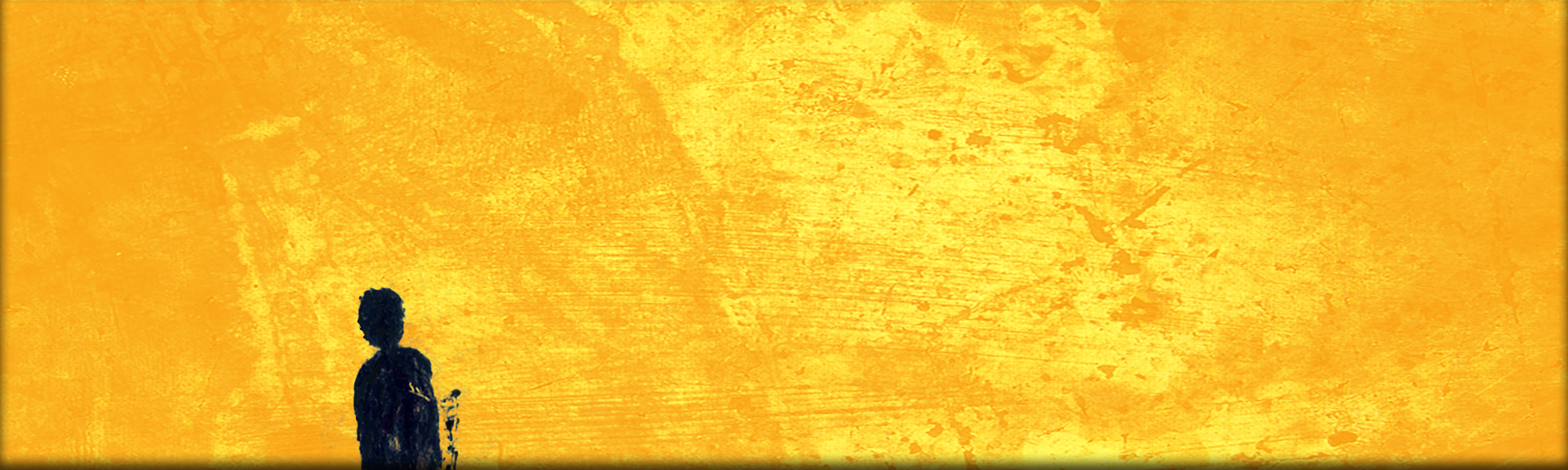J’ai médité avec mes pieds. Il en est resté ce qui suit…
Vous avez lu le poème de Jean ?
Jean, le célèbre auteur à mystère, l’accoucheur déraisonnable d’une œuvre à tiroirs ! C’est un élixir ! Son prologue est alcool fort, drogue pour marcheurs, dopant pour pèlerins, qu’ils soient de Compostelle ou d’ailleurs. Il semble qu’on ne puisse l’entendre qu’avec les pieds, le comprendre que par les pieds. Il vient d’on ne sait où, de très haut, de très loin et plane tant et si bien que la seule attitude qui convienne est de le marteler, le visser dans le sol avec ses pas, l’enfoncer en terre avec ses godillots, l’écraser rageusement sous ses semelles ‘Vibram’… Altitude zéro, voilà le sort à lui donner, voilà ce qu’il mérite !
Ce que je fais, déterminé.
Je lis, je marche, je lis, je marche. Encerclé, étourdi, cerné par la nuée de mots, je scande mes pas des dix-huit versets de ce vertigineux poème. Les premiers mots tournent, tourneboulent et mettent carrément la tête à l’envers. Je ne comprends PAS, je ne comprends RIEN. Un mot revient, leitmotiv étrange et lancinant, verbe qui ne se déclinerait pas mais s’emploierait au seul substantif et toujours avec déférence, jamais sans majuscule. Ce mot, c’est lui : « Verbe ». Précédé d’un article qui le personnalise : « le Verbe ». Qu’est-ce à dire ? Reprenons, pas à pas, depuis le début…
Au commencement – un PAS – était – un PAS – le Verbe – un PAS –
et le Verbe – un PAS – était – un PAS – vers – un PAS – …
et le Verbe – un PAS – était – un PAS – …
Il – un PAS – était – un PAS – au commencement – un PAS – vers- un PAS – …
un PAS – – un PAS – – un PAS – – un PAS –
un PAS – – un PAS – – un PAS –
un PAS – – un PAS –
– un PAS –
La suite n’est pas plus compréhensible que le début…
Je suis saisi par l’hermétisme, le non-sens de ces mots. Et malgré tout pourtant, je me sens interpellé. Je flaire une vérité abyssale à mettre à nu, une profondeur seconde à découvrir. Je sens l’air frais, le plein vent qui circule. Je continue, le chemin et les autres versets. Tout cela cent fois, mille fois, plus encore peut-être. Je scande ces mots jusqu’à plus soif et au fil des jours, je lance aussi des mots, comme ça, au gré du vent, pour entendre, pour voir…
Au commencement
depuis toujours et pour toujours.
Au commencement
au-delà du temps, au-delà du sens.
Au commencement
comme une éternité, sans début ni fin.
Au commencement
comme une manière de dire plutôt qu’un fait.
Au commencement
comme évidence de langage,
Principe,
Réalité déjà réalisée…
Au commencement
point final.
Rageur, je m’arrête.
Un lombric traverse le chemin, passe sous ma semelle de chaussure, s’installe, reste, ne sort pas de l’autre côté. Je n’ose bouger. Élan immobile, qui dure.
Ainsi le Verbe est là,
dans un présent éternel qui n’a ni passé ni futur.
Point inaugural sans début.
Point final sans fin.
« Là est le Verbe»
Un point c’est tout.
Rien de plus ? Rien. Rien du tout, absolument rien !
Accroche-toi, me dis-je, le vertige te gagne.
Vertige verbal, soulerie de mots. Là ? Où ? Qu’est-ce qui est là ? Et où ? Rien ? Tout ? Tout ou rien ? Rien et tout ? Tout serait-il réductible à un mot, un seul mot : Verbe ? Verbe sublime qui ne se décline mais qui est.
Tout ça c’est jouer sur les mots et point trop n’en faut !
Préférons le silence ! Contentons-nous du silence éternel ! Car on peut se suffire dans l’écoute de ce qui est. On peut se contenter de vibrer au son de ce qui est dit, harmonique ténue, vibration intime, infime et fine. On peut, mais l’homme est langage, appelé à la symphonie, à l’orchestration alors il se tourne vers l’autre pour comprendre, se conforter, s’accorder. Il participe d’une relation. Et se tournant vers l’autre, l’homme est à l’image du Verbe qui est relation aussi. Relation orientée. L’orient du Verbe, c’est l’au-delà de lui.
Au-delà ?
Le Verbe est tout entier tourné vers l’au-delà. Au-delà, on ne peut dire plus. Si on s’y hasarde, le risque est grand du lieu commun ou du désaccord, de l’invective, de la bagarre. Restons prudent ! Le Verbe, dans sa relation avec cet au-delà est alors si proche de lui que leurs regards respectifs ne sont qu’un seul et unique regard. Et au bout du compte, se donnant et s’épuisant sans cesse l’un l’autre dans la transparence du même, ils sont Un !
Simplicité.
C’est simple au fond, me dis-je. Ils sont Un comme un et un font deux. Deux amoureux, cela va de soi !
Mais attention !
Il faut préciser. Amoureux s’écrit là avec A majuscule et trait d’union – le Regard – majuscule lui aussi. Il met à nu.
Au commencement
comme une fête dont on ne se dit plus que c’est une fête
tant elle est devenue seconde peau,
innée, familière, coutumière.
Au commencement
comme des noces dont on ne sait plus quand elles ont commencé
tant elles sont volupté,
félicité,
pur bonheur.
Au commencement
d’une relation amoureuse…
Parfait !
Tournée vers l’autre, toute relation est aussi en puissance relation majuscule car elle vibre du Verbe, cette relation-là. Depuis toujours il est ! Tout est par lui et sans lui rien n’est. La relation ne peut donc pas ne pas vibrer de lui. Verbe qui est tout et qui pourtant n’est rien que l’on puisse exprimer. Verbe insaisissable qui est rien et qui pourtant est tout. Tout et rien, comme un couple mystérieux, sans cesse réapparaissent et cette fois, c’est sûr, ce n’est plus un jeu mais un enjeu…
Que vibre cette Relation !
Et me voilà pris dans les tourbillon, maelström, vortex dans lesquels sans tarder elle immerge ! Comme l’eau aspirée par la trombe rejaillit en geyser je suis projeté hors de moi et curieusement aussi, recentré. Hypnotisé et captif, je deviens tout à la fois étincelle et feu, brindille et foyer, attraction et attrait, regardant, regardé. Que vibre cette Relation et me voilà extasié… Le pied ! Facile.
Au commencement
au-delà
de toute dualité,
contradiction,
conception,
imagination même.
Au commencement
d’une relation avec ‘R’ majuscule.
Que vive cette Relation !
Et l’homme, tourné vers le Verbe, est tant et si bien tourné vers lui, qu’il est… le Verbe.
Au commencement est le Verbe
Et le Verbe est vers moi
et le Verbe est…
moi !
Verbe qui est là.
Depuis toujours. Verbe qui est Tout. Qui est. Un point c’est Tout.
Au commencement
dans le Principe de ce qui est.
C’est dit.
Et c’est un dit de pieds ! Car ce sont eux qui oeuvrent, ce sont eux qui – paradoxalement, je le concède – entendent. Je vous assure et sans Jean paraphraser, sans eux rien n’est ! Mes arpions sont des champions ! Promus et révélés magiques archets, ils éveillent et font vibrer des cordes d’or insoupçonnées, bien enserrées dans l’océan bleu de l’âme. Ils en usent et abusent, ces brigands, à jamais s’arrêter.
Et sourd, à petits pas, le chant du monde…
À travers les ampoules que tout chemin mérite, mes pinceaux inlassablement tracent, dessinent et enluminent les cinq lettres, cinq lettres d’or. Cinq lettres lancinantes et magiques dans l’entrelacs des jours :
– V – E – R – B – E –
Et monte l’évidence.
Ce Verbe-là qui est, ce Verbe est gerbe, gerbe de lumière ! Dès lors, dans son attraction promu et installé, devenu photophore, je tourbillonne, amis de coeur, je porte la lumière comme elle-même me porte ! Car c’est là le sens de l’incise littéraire, des pieds ramenés sur la terre au milieu de cette haute volée d’oiseaux-mots. Le prologue est plus qu’un viatique, une roborative nourriture, c’est une grenade dégoupillée, une bombe, une mine enterrée sous nos pieds ! Nos pieds ! Les pieds de tous ! Ces pieds sont ceux de Jean bien sûr, l’un et l’autre Jean, celui qui baptise et celui qui écrit mais ils sont aussi ceux de Jacques, celui de Compostelle évidemment, celui de la chanson aussi et tous les autres Jacques ! Ces pieds sont tout autant les tiens, ami pèlerin, pareillement les vôtres, compagnons de marche et de bivouac, frères de fortune et d’infortune. Du moins y-a-t-il appel à se sentir concerné, impliqué. Du moins y-a-t-il invite à reconnaître sa pointure, sa foulée.
Quand passe la lumière.
Elle court, traverse, transperce, engendre. Hier comme aujourd’hui et comme demain. Si je ne fais pas écran, ombrage, si je n’oppose pas barrage et protection elle prend les choses en main. Flambeau qui marche en-tête, elle ouvre la route et d’un simple badaud, d’un pauvre passant, elle fait un témoin. Témoin hébété qu’elle propulse prophète. Prophète stupéfait qui n’en peut mais, mais s’éveille interprète. Interprète bancal, soit ! Borgne et titubant certes ! Mais porteur de lumière, toujours inspiré, transporté, ravi et enivré, « osmosé » par elle. Voilà la magie, la magie du Verbe ! Et ce n’est que prémices d’un envol bien plus fol !
Je sais, je vole.
Le Verbe a éveillé la fibre jusque-là endormie. Il a dévoilé la tâche de naissance baignée de nostalgie. Me voilà à la dérive et loin de me perdre pourtant, je trace la route optimale, courte, droite, directe. La dérive est raccourci, le raccourci bonheur ! Sur ce chemin de crête, seul le Verbe balise et luit. Phare, il indique le port, même dans ses occultations. Flash, éclat, toujours lumière vive il illumine, foudroie parfois. Souvent par intermittence, jamais sans surprise. Principe, il se révèle germe, gène à l’œuvre dans toute la création. Sans lui, rien n’est.
Et pour l’heure, il est…
Dans mes chaussures ! J’ai ramené le ciel sur la terre, j’ai conjugué le Verbe avec mes mots, je l’ai pressé, foulé, pressuré, trituré avec mes pieds. Prologue, ton sort en est jeté ! Quelle étape mémorable ! Gravée au cœur comme l’est un premier amour. Pour l’heure, passons à la suivante. Le livre s’ouvre davantage. Le vent s’engouffre entre les pages et noue, sans fard et sans détour, le dialogue vrai.
– Qui es-tu ? Que dis-tu de toi-même ?
Telle est la question posée à l’homme.
– Je ne suis rien que celui qui baptise,
celui qui met au monde et fait advenir ce qui est.
Ce qui est ?
Le Verbe !
Sitôt quitté, le prologue revient et rejoue sa musique.
« Lui qui derrière moi vient,
devant moi advient,
car avant moi, il est »
Phrase-clé !
Belle réponse que celle-là. Magnifiquement énigmatique, elle reste la plus belle phrase qu’un homme puisse former, balbutier, articuler et mettre en œuvre dans le temps de sa vie. Elle est pétrie de Verbe, cette phrase-là ! Il circule et s’exhibe, se donne à voir et donne à voir. Il passe et passant, il change le regard. De celui qui voit et de celui qui est vu. Il passe par soi, à travers soi. Il éclaire, rend luminescent. Le Verbe, cette lame de fond imperceptible et pourtant si puissante qui remonte à contre-courant de l’inexorable dégradation de la matière.
Quelque pas pour se détendre, laisser descendre…
Tout est affaire de regard et dans le regard, de ricochet. Il regarde l’homme.
– Que cherches-tu ?
– Où demeures-tu ?
– Viens et vois.
Alors, celui-là, regardé, voit et demeure près de lui le temps d’une fulgurance de regard… Il ne peut qu’appeler son frère… Il regarde l’homme, le frère.
– Tu seras Pierre, roc, rocher.
Je m’assois sur une pierre, justement là, à ce moment. Elle semble comme une invite…
– Suis-moi.
Je me lève bien sûr… et redis à mon frère les paroles entendues :
– Viens et vois.
Le ricochet perdure. Il regarde l’homme, le frère.
– Tu verras davantage. Tu verras les cieux ouverts, le ciel à l’œuvre sur la terre où il a sa demeure.
Le frère est étonné.
Il ne voyait en lui qu’un être providentiel, tout à la fois religieux et politique, qui allait résoudre tous les problèmes, apporter toutes les solutions. Or quand il regarde l’homme, ce n’est pas pour discuter politique ou religion. C’est pour lui dire tout autre chose. Il donne à l’homme d’entendre que ce qu’il perçoit dans une fulgurance de regard est gage d’éternité. C’est immense, beaucoup plus grand que la politique, beaucoup plus élevé que la religion. Mais cela, il ne le donne à voir qu’en tête à tête, en aparté, en face à face, dans l’imbrication du regard.
Jusqu’au jour des noces où là, tout s’accélère.
Les gens voient, les gens savent, les gens s’étonnent.
Que dit-il à l’homme, ce jour-là ?
« Puise et porte !».
Formule admirablement condensée.
Répétée, mâchonnée, macérée au fil des pas, elle exhale un mystérieux arôme, une fragrance à offrir :
«Va au fond de toi et recueille ce qui s’y trouve.
Et alors, offre !»
Au fond de soi ?
Y-a-t-il donc quelque chose au fond de soi autre que viscères et boyaux ? Oui, il y a quelque chose, quelque chose d’immense, tapi, lové, comme en attente. En attente d’envol, de déploiement.
Contraction.
Quelle est la force souterraine qui fait ainsi bouger les lignes tout à coup ? Qui fait trembler le sol et condense les choses ? Qui pousse ainsi le Verbe à se révéler, à prendre toute sa puissance ? Qui sinon la femme, la mère qui le porte à ses destin et apogée ?
Et déjà une mère, un fils…
Mère et fils à eux deux donnent ensemble la clé. La clé du domicile. C’est là, au domicile de chacun, en toute maison, en tous lieux et occasions, que les cieux s’ouvrent. Naissance, mise au monde. Plus d’hypocrisie ! Le Verbe est là. Il vibre, nettoie, purifie, débusque, dénonce. Grand ménage de printemps au lieu du sacré ! Plus de commerce malsain, plus de compromissions, de mesquines affaires. Braderie, derniers jours de soldes. Voici la place nette du grand vide requis. Sitôt fait, les trois coups sont frappés d’une entrée en scène à vous couper le souffle.
Comme en acompte, l’espace vibre.
Le chant puissant du compagnon de bivouac l’emplit :
« Tous les matins nous prenons le chemin
Tous les matins nous allons plus loin
Tous les matins la route nous appelle
C’est le chemin de Compostelle...»
Et l’infini rejoint, qui ‘frère encore’.
« Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d’une possible fièvre
Partir où personne ne part.
Telle est ma quête… »
Que tenaille la quête.
La voie est libre, il va plus loin, toujours plus loin. Sans hésitation, il désigne le lieu. Du temple au domicile, du domicile au corps ! Il se met à nu. Son corps-même est le lieu du sacré ! Voilà ce qu’il révèle ! Comme tout corps l’est de même. Voilà la surenchère ! Plus rien à rajouter. Le point semble final.
« Là est le Verbe »
Mais la reconnaissance tarde.
Car ce qu’il y a dans l’homme est sombre. L’éclairage pourtant est possible, l’éclaircie à portée. Et l’arc-en-ciel la dit quand la terre est lavée au soir noir de l’orage. Du sombre pied de l’arc qui du tumulte nait, la courbure s’élève, va chercher la lumière puis retombe d’où elle vient, par le haut engendrée. Ainsi l’homme renaît et laisse le Verbe être. Cet homme voit les cieux s’ouvrir : Verbe et au-delà sont là. Il le sait. Savoir, c’est tenir. Ne tenir qu’une chose :
« Je ne sais
ni d’où je viens
– car c’est inconnaissable –
ni où je vais
– car c’est le même inconnaissable –
mais je sais que :
‘il faut que Lui croisse et que moi, je diminue‘.»
Face à Face.
Au delà des relations – des plus lointaines au plus intimes – je suis seul. Seul face à Lui, le Mystère. Seul face à Elle, la lumière. Jamais seul donc.
Balbutier.
Ne reste qu’à balbutier, à participer en bredouillant la lente avancée de ce mystère, de cet incroyable destin qui fait de nous tous – qui que nous soyons et quoi que nous fassions – des épousés, des ‘osmosés’, des ‘poreux’ de l’Immense…
Il y faut du courage.
Nous croyons avoir la vie alors que c’est la vie qui nous a ! Elle va vers son devenir, à travers un énorme gaspillage, un jeu dramatique d’essais et d’erreurs, un désordre de fureur, de sperme et de sang, un amoncellement de refus et résistances mais aussi par le biais de trésors d’intelligence déployée pour entrer dans son mystère, pour aimer ce qui arrive, pour pénétrer et connaître l’univers, sa formation, son devenir. C’est là, dans cette quête harassante, cette tension, que peut se situer la grandeur de l’homme.
Paradoxe !
Étonnamment pourtant, la grandeur réside dans l’abandon. Dans celui-ci, se tempère l’impatience d’Être de la vie et se démêlent toujours plus avant les lignes incompréhensiblement intelligibles de l’à-venir du mystère : les noces, l’osmose, l’unité. Dans l’abandon, l’homme participe de l’incroyable porosité de l’infini et peut en mesurer tout à la fois la stupéfiante grandeur et l’impensable proximité.
Verbe.
Verbe, tu deviens mon ami et je te sais intime principe de vie grandiose. Cette vie c’est ma vie. L’intime et l’Immense sont Un.
« Il faut que Lui croisse et que moi, je diminue »
Abîme.
L’abrupt, l’insaisissable percute, perfore. Cette croissance-là est épopée, plus encore qu’éveil. Ce qui est grand est dans le tout-petit comme le tout-petit – c’est plus accessible à mon esprit – est dans l’infiniment grand. Disons-le simplement. L’infini est en moi comme je suis en lui. Tout est dans tout. Et rien n’est figé. Au contraire, l’infiniment grand s’accroît de ma corrélative et tout autant infinie diminution. Tout ce que j’ai patiemment acquis et qui me structure est nécessaire et bon sauf le risque de s’en enorgueillir et de s’y arrêter. Il faut abandonner superbe et fierté, au final peu de chose, pour accéder à l’Immense…
Hébétude.
Quelque peu secoué, je m’arrête de marcher et je sors du sac ma maigre pitance de pèlerin. L’ordinaire des jours : sardines en boîte, quignon de pain et pomme. A l’heure de la pause, mon livre s’ouvre à la bonne page : il est question de ‘nourriture’. Certes l’homme – d’ailleurs ici, c’est une femme – boit, mange, travaille, décide et connait la fatigue des jours. Certes cette personne a des amis, des sentiments, une vie familiale et affective avec ses hauts et ses bas. Plutôt des bas d’ailleurs, si je lis entre les mots… Certes elle a ou elle n’a pas de religion et pratique un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout. Tout cela n’a pas grande importance, seul compte le désir. Désir d’entrer sans fard dans une volonté Autre et de participer d’elle.
« Il faut que Lui croisse et que moi, je diminue»
« Je est un Autre ».
Le cuivre s’éveille clairon. Le poète aux illuminations l’a dit ! A-t-il voulu la majuscule et le sens qu’elle porte ? Il semble difficile d’avoir écrit comme il a écrit, d’avoir vécu comme il a vécu sans avoir vu. Voir ? Mais qu’a-t-il vu ? La lumière, aucun doute là-dessus. Et peu importe au fond. Tout flamboyants que sont ses écrits, il n’est que signe. Seule la Majuscule est et c’est cela qui importe. Elle est et il est impossible de ne pas se réjouir vraiment. N’éludons point l’étude, n’évitons de conclure : vivre, c’est s’éveiller Autre ! Se savoir, se vivre plus grand que soi. Plus je sais cela, plus je suis humble. Celui qui l’enseigne et entraîne à sa suite c’est lui, le Verbe fait chair, l’homme fatigué, ‘tel quel’, assis sur la margelle.
Là, perdu dans mon soliloque, je m’égare.
Je m’égare vraiment. Distrait, je n’ai pas vu la marque blanche et rouge qui indiquait la bifurcation et me voilà avec un peu plus de fatigue due aux quelques kilomètres inutilement rajoutés. Je n’ai plus d’eau et mes lèvres sèches réclament. Heureusement voilà une source, un puits quelque peu délabré. Je m’assois sur ce qui reste de l’ancienne margelle, je bois au maigre filet d’eau qui suinte, en emplissant ma main, laissant perler le reste et mes pauvres pensées… Tout ce temps, tout ce détour, tout ce grand cafouillage, ce grinçant capharnaüm de vie… Perdu dans mon reflet renvoyé par l’eau trouble, voici que m’apparait un visage de femme empreint de gravité profonde dans l’attention qu’elle porte à l’enfant qu’elle veille. La femme me ressemble, l’enfant de même. Je me retourne vivement. Personne bien sûr ! Illumination. Je sais ce qu’est la vie : une sortie et un retour. Je suis sorti, je reviens. Avec un enfant !
Ça va mal se terminer…
Tu hallucines – susurre à mon oreille une petite voix toute d’acide et de miel – tu perds la tête, mon ami ! Le chemin tourneboule, le puits ensorcelle et te voilà fada ! La fatigue accable, le soleil rend maboul. Insolation, délire, dédoublement de soi. Tu serais femme et enfant et toi-même de plus ? L’asile est prochain gite, pèlerin ! Jamais, ô grand jamais tu n’aurais dû entreprendre cette marche en compagnie de Jean.
Je persiste pourtant.
Peu décidé à admettre critique et avertissement, j’affirme. Je suis fils de prince avec une descendance à assurer. Et quand je porte fièrement par-devers moi l’enfant vivant, je fais croître l’Immense et moi, je diminue. Mon amoindrissement est grande joie car alors je renais. Et pleinement conscient de la grandeur de l’homme, c’est du nom de « Verbe » que je signe ma folie en légitime fierté !
Verbe et temps…
Même s’il m’a fallu tout ce temps pour comprendre, comme au vieux Nicodème, pourtant savant, pourtant lettré, même s’il m’a fallu toutes ces hésitations, ces interminables questions, comme à la femme samaritaine, étrangère de basse condition et peut-être de petite vertu, même s’il a fallu au misérable débauché, enfant du siècle inconsistant et léger que je suis, un grand désordre de vie comme il y en a dans le temple, peu importe ! Le détour en vaut la chandelle et je dis : merci, merci, la vie ! Je suis mère et mère je donne à boire à l’enfant. Je suis fils et fils, je bois et grandis dans les yeux de ma mère. Dans cet échange, le Verbe est là qui se donne en entier, comme une logorrhée-hoquet :
« Femme-voici-ton-fils-voici-ta-mère ! »
Et dans le miroir sans tain de l’antique fontaine, mère et fils à la fois, je ne suis plus qu’Un avec l’Immense…
Il suffit !
Raisonnable à nouveau, je fredonne bien vite les trois ‘R’ qui rassurent : râler, ronchonner, ronronner. Le disque est rayé de mon entendement. Je regrette tous ces détours, papillonnages et fausses pistes. Temps perdu, me dis-je, que ces égarements dans le labyrinthe de vie. J’en suis là de ces inutiles et futiles remords quand je suis pris à la gorge :
« Prends ton grabat et marche ! »
Dresse-toi !
Pris en faute, je me lève et endosse le sac. Ni regrets ni attente, il est vain d’espérer un autre temps que l’instant. Chaque seconde est vocation :
« Prends ton grabat et marche ! »
En avant !
Prends-toi comme tu es et marche. C’est vers toi-même que tu vas. Fais le chemin. Permets que l’œuvre du Verbe s’accomplisse. Concours à l’accomplir en ce lieu où toi seul peux aider à le faire, ton corps, ton âme, ta chair. Ton œuvre n’est autre que celle du Verbe. Toi et le Verbe, vous jouez la même partition pour un seul et unique chant à l’unisson :
« Va vers toi-même ! »
Cri vital.
Cri muet qui forme, informe et tient tout l’Univers. Je m’arrête, sidéré. Force est de reconnaître qu’il m’habite ce cri et m’habite en entier. Il est ma demeure tout comme je suis la sienne. Je pose le sac et avec une détermination de moi inconnue, je hurle :
« Que rien ne m’arrête sur ce chemin d’Humanité ! »
Et le voile tombe.
Celui de mes vêtements, d’abord. Dépouillé et nu, du haut du promontoire où je suis parvenu, j’embrasse d’un seul coup l’entièreté du monde. Ce que je vois m’émeut et au-delà. S’animent à pas pesés une myriade d’hommes, pèlerins qui semblent comme des pantins dans un décor de carton-pâte. Chacun tient à la main cinq pains et deux alevins. Chacun est contagieux à l’extrême, dérangeant, bouleversant, épuré, essentiel. Chacun esquisse des pas légers, des sauts, des entrechats. Chacun danse l’ordinaire d’un Royaume.
Est-ce magie ?
Royale folie ? Insolente ineptie ? Dès que l’air se vicie, dès qu’un doute pareil affleure à la pensée tout s’effondre, décor et figurants. Finis les pas de danse, finie la joie de vivre, ne restent que des cadavres. Et file le Verbe. Il se défile, se retire en solitude.
Solitude ?
Il n’est jamais seul. Il est toujours avec plus grand que lui. Que font-ils tous les deux ? Ce n’est plus un secret, ils prient. Ils prient sur le monde. Et pour nous, qu’en est-il ? Nous ne pouvons être seuls davantage. Le Verbe est là, toujours là. Le symbole est clair désormais des pèlerins-pantins et de leurs pains et alevins. Ressource vive tenue entre leurs mains, ces pains-poissons-là sont signes de la seule chair qui puisse faire se lever l’aurore sur l’humanité. La chair de Verbe.
« Il faut que Lui croisse et que moi, je diminue »
Et s’ouvre le bal.
Rassasiement complet pour valse infinie. Nous sommes poussière d’Immense, informés par l’Immense. L’information est don. Le don est grandeur. Grandeur époustouflante et éprouvante aussi parce que démesurée à la stature d’homme. Le Verbe fait chair en exprime la beauté. Sa mission ? Rendre l’impensable pensable, l’impossible possible. Entraîner à sa suite pour être – tous et chacun – ce qu’il est.
Plait-il ?
Être ce qu’il est ? Mais quel homme est-il vraiment ? Ses disciples le cherchent là où il n’est pas. Il ne veut pas aller avec eux là où ils vont. Il ne veut pas aller non plus de la manière dont ils vont. Avouez qu’il y a de quoi se poser des questions, de quoi être intrigué. Et ceux qui s’interrogent doutent. D’où vient-il ? La réponse jaillit : son origine est en lui. Il est source et fleuve, cause et effet tout à la fois ! Tollé ! Hérésie ! Non-sens ! Aporie ! L’un d’entre ceux qui doutent s’avance tout de même pour couvrir le tumulte :
« Examinons l’affaire…
Ne jugeons pas trop vite… ! »
Jouons !
Examiner l’affaire, pour l’heure, c’est jouer à la balle. Cela semble plaisant. Et cette balle, placée au centre, est tenue par les mains trop tendres d’une femme. Soit ! Mais en fait, la femme n’est que prétexte. Car ce qui est ici pointé, ce sont les lignes de vie courbes et sinueuses et tortueuses. Ce qui est désigné ici c’est la tromperie, satisfaction jamais satisfaite de ses propres nature, ego, vouloir. La nature-même de l’homme ne lui donne pas les moyens d’être à la hauteur de ce qu’il peut être. Les plus vieux le savent qui ont passé leur vie assis sur le volcan trop souvent éruptif des passions…
Remède ?
Il existe, à portée d’homme. Il est donné par ce mouvement en deux temps qui seul permet d’écrire le plus droit possible la trajectoire d’une vie. Ce mouvement c’est l’alternance sans faille de l’action et de la contemplation, la succession tranquille de la prière en solitude et du vivre ensemble parmi les siens. Va-et-vient salvateur, indispensable, seul capable d’unifier, de centrer. Balle au centre à nouveau !
La donne a changé.
Celui qui tient la balle à présent, c’est lui ! Et les pierres qui n’ont pas atteint la femme – et ce n’est que justice – pleuvent sur lui – et ce n’est qu’injustice. Et le constat est là, douloureux à dresser mais implacable : le remède est intolérable aux hommes.
Et les symptômes résistent.
Revient la question, insistante, dérangeante. Qui mettre au centre, cette fois dégagé et pour toujours des faux-semblants, des illusions, des apparences ? Lui encore et toujours bien sûr mais toute sa personne continue d’interroger, d’intriguer. La question se déplace, se prolonge : qui est-il, d’où vient-il ? Question de paternité en somme.
La réponse fuse :
« Je suis »
Réponse fulgurante suivie d’un infini silence, seulement supportable dans la parole qui le porte :
« Si vous demeurez dans ma parole vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre »
Vérité ?
La vérité du disciple c’est de se savoir abri de l’Autre. L’Autre, cet hôte reçu qui tout autant reçoit. Présence qui rend tout disciple libre d’oser se vivre et se dire habité par l’Immense. Ce « Je suis » mystérieux qui donne croissance au monde.
Chaos que le monde !
Son évolution certes est chaotique, irrégulière, brownienne. C’est ainsi. Il n’y a ni fatalité à déplorer ni culpabilité à cultiver dans cet état de fait. Tout ce qui arrive n’est que circonstances. Favorables ou handicapantes, elles sont nécessaires. Car une nécessité subsiste. Celle de patauger, immergés que nous sommes dans la boue de la terre. La boue elle-même est discriminante et propose le choix. Ne voir que la boue ou bien, à travers la boue, discerner l’ailleurs de la boue. Tel est le défi, l’enjeu, la gageure. Le monde semble un immense désordre mais sous l’apparente loi du chaos, de l’entropie et de l’inexorable dégradation de la matière court, secrète et bien plus forte encore, une autre loi, celle d’une remise en ordre d’un tout autre ordre…
Et justement, il pleut.
Le pays est lavé. La glaise colle. La cape de pluie gêne. Je glisse, je patauge, je me raccroche à mon étoile et surtout, soyons sérieux, à mon bâton de pèlerin. Dans un élan insensé, j’exulte :
« Que je n’ai pas l’ombre d’un doute sur le ‘fils de l’homme’.
Pour les chemins boueux, hip hip hip… HOURA !!!»
Aussitôt, c’est la chute !
Je tombe, mon livre aussi. Je ramasse les deux. Mes mains sales et boueuses maculent la page, surlignent un passage. La chute devient extase. Comme suspendu entre temps et espace, je reste dans l’effarement de ce qui est rapporté là, couché sur le papier jauni de cet explosif travesti en livre :
« Le Père est en moi comme moi dans le Père.
Nous sommes UN »
Père ?
C’est l’au-delà du fils. Au-delà, point toujours final. Rajoutons cependant. Un père est plus grand qu’un fils mais juché sur ses épaules, le fils en voit d’autant son horizon élargi. Ainsi l’oeuvre des deux est-elle toujours plus grande. Dynamique de la vie.
Unité ?
L’humanité est Une parce que l’humanité est Verbe. Toute entière Verbe.
Humanité ?
Le Verbe informe, donne forme et anime la matière, dont nous sommes. Le fils de l’homme est Verbe et c’est ce fils que l’homme doit être. L’Immense est là qui donne capacité de s’engendrer soi-même. Diffusion-infusion-perfusion de vie à l’infini. Impensable porosité de l’Immense. Improbable don.
Je traverse un village.
Les villageois accompagnent à sa dernière (?) demeure l’un des leurs. Je demande pour qui sonne le glas. Lazare Dormion, m’est-il répondu, de la ferme d’à côté, vous savez la vieille bâtisse en terre crue, juste à la sortie du village, non je ne sais pas, comment voulez-vous que je sache, je ne fais que passer, je suis pèlerin, itinérant, en errance même. Le nom sonne pourtant comme familièrement à mes oreilles et bizarrement, je me sens quelques atomes crochus avec ce Lazare Dormion…
Qui est Lazare ?
Qui est Lazare sinon moi ? Que sont ses bandelettes sinon tout ce qui m’empêche de voir l’ultime réalité derrière l’écume des jours ? Qui sort ? Ce n’est pas Lazare, du moins Lazare seul. C’est le Verbe en Lazare qui anime, redresse et au final sort du tombeau. Et du prologue revient le lancinant refrain :
« Lui qui derrière moi vient, devant moi advient, car avant moi, il est»
Il y faut la prière.
La prière des sœurs, les sœurs du frère, le sourd. Prière seule qui donne pouvoir au signe de se manifester. C’est parce que Marie prie et prie juste que Lazare sort. Nous sommes Un.
Entendre ou attendre ?
Tout cela n’est audible que si j’entends. Cocagne s’il m’est donné d’entendre de mon vivant ! Cocagne si je n’ai pas à attendre de mourir pour entendre comme le fait ce pauvre Lazare, insensible et sourd sa vie durant ! Entendre le Verbe en soi et l’aider à oeuvrer, voilà la voie, voilà le choix ! Être d’ores et déjà ici et maintenant un grand vivant. Car tenir un jour, à l’instar du pauvre Lazare dans cette stupéfiante scène, le rôle ahurissant de l’hébété grandiose sortant du tombeau, est-ce sort enviable ?
Traverser.
Traverser la mort avant son heure, tel est le défi. La sortie de Lazare est signe. L’au-delà du signe, c’est la lumière, l’appel à être fils, fils de lumière. Et le fils de lumière sait d’où il vient et où il va. Il se dépouille, se met au service. Le service dont il est question n’est rien d’autre que de signifier aux hommes leur origine qui est destinée. Comment les aimer mieux ? Mais le chemin est raide, la trahison guette et la faiblesse tente.
Faire mémoire.
Seul antidote.
Au commencement,
Au commencement de chaque jour
être tourné vers Toi, être en Toi, être Toi.
Tout est entre mes mains
et sans mes mains rien n’existe.
En moi est la Vie,
précieuse, inestimable et éternelle.
Qu’importe l’écrin
qui porte le joyau !
Et la Vie
pousse à annoncer
la Vie.
Voix secrète,
sourde et profonde.
La lumière est.
Pur Don.
La lumière est chair.
Elle est ma chair,
comme elle est
toute chair.
Pur Son.
Je suis,
Lumière,
avant même le commencement.
Tout est entre mes mains.
Le chemin est tracé,
le chemin de lumière
qui est la Source même.
Évidence.
Le chemin est la source du chemin. La cause est l’effet tout autant que la cause. La mère est le fils et le fils devient mère. D’un même élan il s’engendre et se laisse engendrer. Le désintégrateur de sens qui a mis si rudement à l’épreuve et mes pieds et ma tête dans le prologue de cette course folle continue inexorablement son travail de sape. Mais il y a de l’allégresse maintenant à se laisser broyer, triturer, épurer jusqu’à l’irréductible conclusion : séparé de toi, l’Immense, je ne peux rien faire. Je suis sec, dérisoire, inutile, mort-vivant. C’est seulement quand je suis toi que je suis vraiment homme. Ni séparé de toi, ni confondu mais Un avec toi, là où je est un Autre.
« Là est le Verbe »
« Là est le Verbe, là est le Verbe…» martèlent sans trêve des pieds ragaillardis. Depuis le prologue la rengaine vrille et obsède et envoûte. Sortir et revenir, tel est le chemin, voilà ce qu’elle ressasse. Connaître le monde et sa souffrance et au cours de la traversée voir sa conscience croître, voilà ce qu’elle dévoile. Conscience d’être au cœur du Verbe, le Verbe au cœur.
Dis-le autrement, pèlerin !
On se tutoie sur le chemin, tu le sais bien :
« Le chemin de l’Immense, c’est toi ! »
Soi ?
Le chemin de l’Immense n’est autre que soi. Voilà le bruit des pas, voilà l’apothéose, voilà l’apocalypse! Omniprésence ! Mais il faut préciser, pointer l’obligatoire. Le Verbe n’est pas sans sa dernière prière qui est appel déchirant à l’Unité. Unité de l’Amour. Le Verbe n’est pas sans le monde qui est immense bourbier. Bourbier et cependant lumière. Le Verbe n’est pas sans les pèlerins qui pataugent. Pèlerins en chemin. Le Verbe n’est pas sans lui, l’au-delà du Verbe. Le Verbe n’est rien, sauf tout.
Couple.
Le couple à mystère – rien et tout enlacés – émerge à nouveau, bras dessus, bras dessous. Tout est dans tout sinon rien n’est, chantonnent-ils ensemble. Tout est dans tout et tout est Un, chantent-ils à l’unisson. Le chemin est la source, la source est le chemin. Voilà l’inclusion folle et lumineuse, faramineuse et vraie. Voilà l’abîme qui sépare et qui est pourtant franchi. Tu es, je suis, nous sommes tous singularité de l’Immense ! Ainsi donc, mon cher Jean, les tiroirs sont ouverts de l’abscons initial. Le Verbe se décline en autant de sujets que l’univers en porte.
Oser.
D’avoir osé dire, Verbe fait chair, tu meurs. Tu meurs parce qu’aux yeux des hommes, ce dit-là n’est pas encore audible. Tu meurs mais la mort n’arrête rien et par toi l’expérience est complète de l’homme. Tu vis. Tu es. Je suis.
Et j’ose.
J’ose le ricochet :
« Viens et vois »
Que vois-tu ?
La lumière.
Brèche, instant, joie.
Vie comblée.
Le ricochet perdure.
Accroche et appât
fugitifs, vitaux, essentiels.
Passant.
Et le passant qui a dit
n’a plus,
tout en étant,
qu’à disparaître.
Et c’est très bien ainsi.